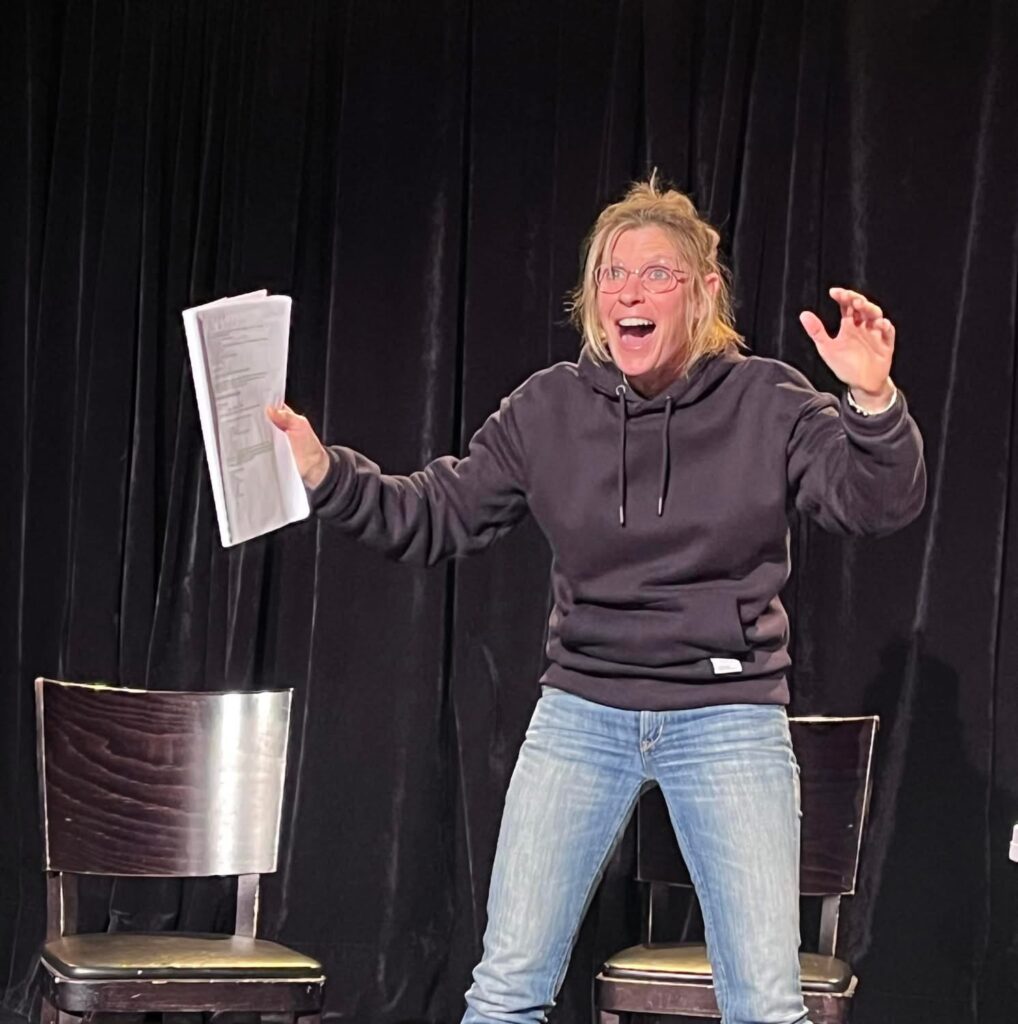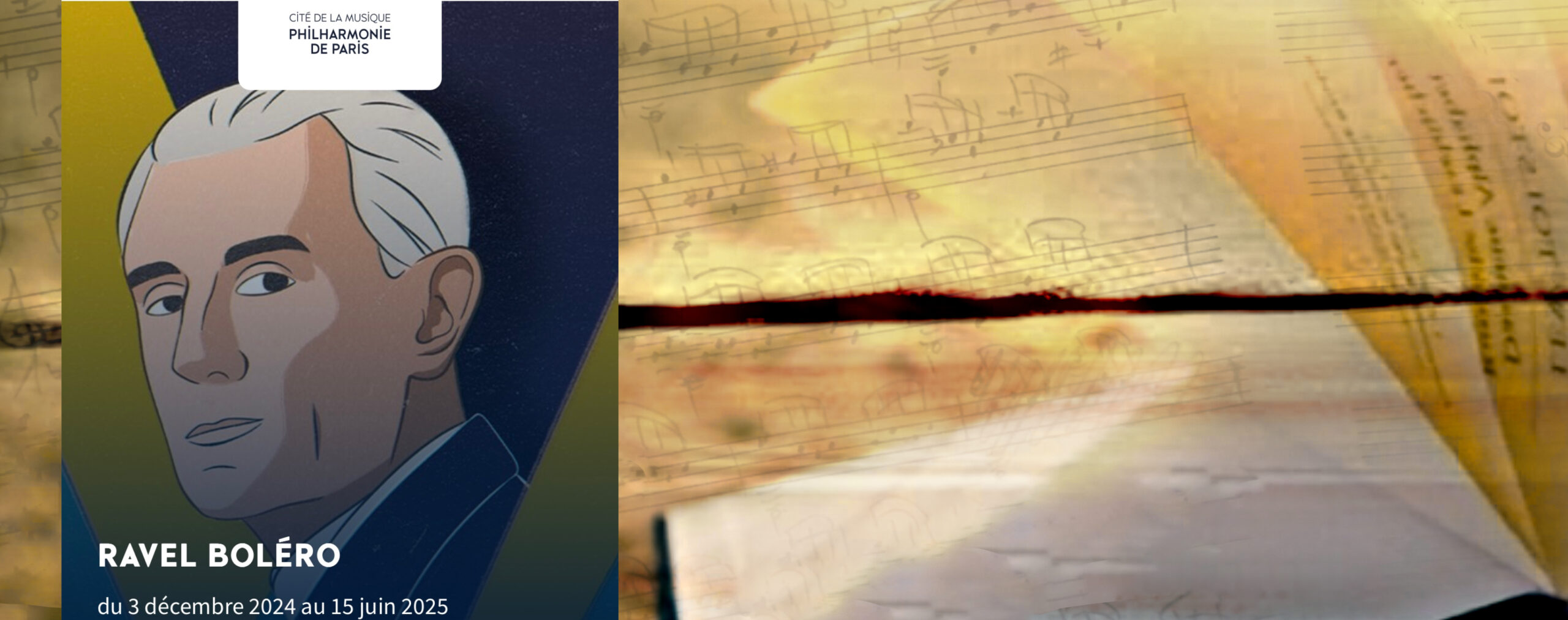« Traverser les murs. Déraisonner la géographie. Se munir de l’épée du Temps contre les oublis et célébrer les grâces. Prier pour l’ami afin qu’il s’apaise. Demeurer en équilibre sur un sifflement de geai… »
Et nous reconnaissons l’écriture du grand magicien des mots, de l’équilibriste du temps, du gardien d’un singulier cabinet de curiosités
Nous reconnaissons Eric Poindron
Cette fois, le « lieu-dit » est un cabaret. *Au cabaret des oiseaux et des songes*
Il y a comme toujours chez l’auteur une invitation au voyage.
Denis Grozdanovitch, dans sa formidable Préface dévoile un peu de la géographie et des mystères de ce voyage.
– Plongez-vous sans tarder dans le merveilleux ouvrage d’Eric le maestro et laissez-vous porter par le sortilège des plus beaux songes…
Et nous plongeons…
Ce « roman d’escapades » est infiniment beau.
Nous retrouvons les obsessions d’Eric Poindron : l’enfance, le temps, les amis perdus, les siècles de littérature qui s’entrelacent, les princesses mortes, les fantômes et les papillons…
Nous retrouvons Éric Poindron. L’auteur sait être pudique. Alors il convoque Gilles Lapouge pour nous dire :
– Je crois que tous les hommes sont faits de même ; la première destination de leurs voyages est leur enfance… »
Il y a aussi Gérard de Nerval qui lit dans la paume de notre main :
« Et de blancs papillons la mer est inondée »
Et nous revoyons les étranges papillons d’Eric Poindron, nous revoyons ses fantômes et nous l’entendons murmurer :
– C’est un peu de moi-même dans ces terrains vagues où se déploient lentement, et sans mon consentement, les souvenirs de celui que je fus…
D’autres témoins, traversent aussi ce roman d’escapades. Pascal Quignard bien sûr, Georges Séféris, Alexandre Dumas, Stevenson, Madame de Sévigné, Ioan Botezãtorul Broascã, et…
Et de temps en temps revient le jeu questionnaire dont l’écrivain est friand :
– Qui est cet être proche que l’on cherche à raconter ? Le silence d’une larme ; le vent dans une confidence…
Et encore le jeu de Collin Maillard et là, Eric Poindron nous aide à trouver au moins un des personnages :
– Quand j’écris une histoire, sans que je ne le dise à personne, en secret, c’est un peu de moi qui se glisse derrière les mots et je deviens ainsi le personnage clandestin de ma propre histoire..
Mais ce grand poète, cet enfant de Reims convoque dans ce roman, peut-être plus qu’ailleurs ce père tant aimé. L’homme des promenades. Celui qui continue de son ailleurs de lui faire signe de la main…
Notre érudit, car il l’est, va encore rameuter les mots des autres, les siens…
Nous entrons dans les dédales de ses bibliothèques intérieures. Dans son monde où chacun est passe-muraille. Nous traversons des pays, des villes. Nous nous allongeons sur des sables d’aurore.
Nous regardons des couchers de lune.
Nous rencontrons des poètes, des « illuminés » de tous les siècles, des magiciens, des illusionnistes, des gardes fou, des princesses noyées étendues sur un lit de fleurs, des fées qui courent la lande, des hirondelles en vertige au-dessus des vagues et toujours un bateau… pour revenir, pour ne pas naufrager :
– Un bateau vague, brise les veines des eaux de nuit. Ça scintille en noir et blanc, même dans les eaux de nuit et de peine…
Et nous caressons doucement la très belle couverture du livre. Cette « improbable aurore boréale au Gerbier de Jonc » signée Simon Bugnon.
La neige écarlate est là aussi. Elle porte le sang versé des ballons rouges qui n’ont pu s’envoler…
Et peut-être qu’Eric Poindron garde au creux de sa main, la petite cicatrice d’une enfance, du fil de cette enfance qu’il n’a jamais su/pu lâcher…
Alors une fois de plus, il nous convie à un festin, il y a autour de la table tous ces écrivains qui ont compté. Il y a des amis disparus qui ont compté. Il y a des mots qui percutent. Il y a son enfance qui danse toujours, il y a cette porte derrière lui, légèrement entrouverte qui lui permet toujours de s’échapper.
Eric Poindron, notre hôte nous convie « par les vents et les tangentes, au cabaret des oiseaux et des songes ».
L’éditeur est « Le Passeur » !
Peux-t-on mieux trouver pour ce festin ? Pour ce voyage ?