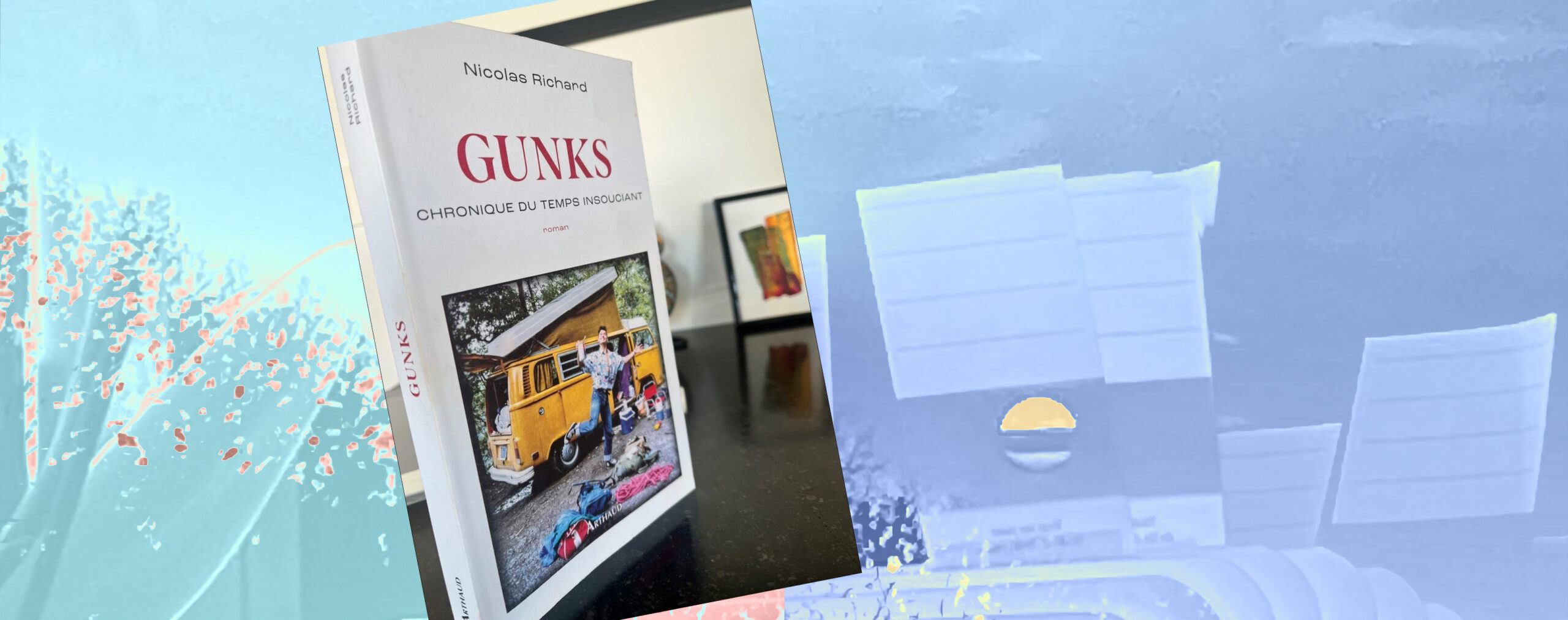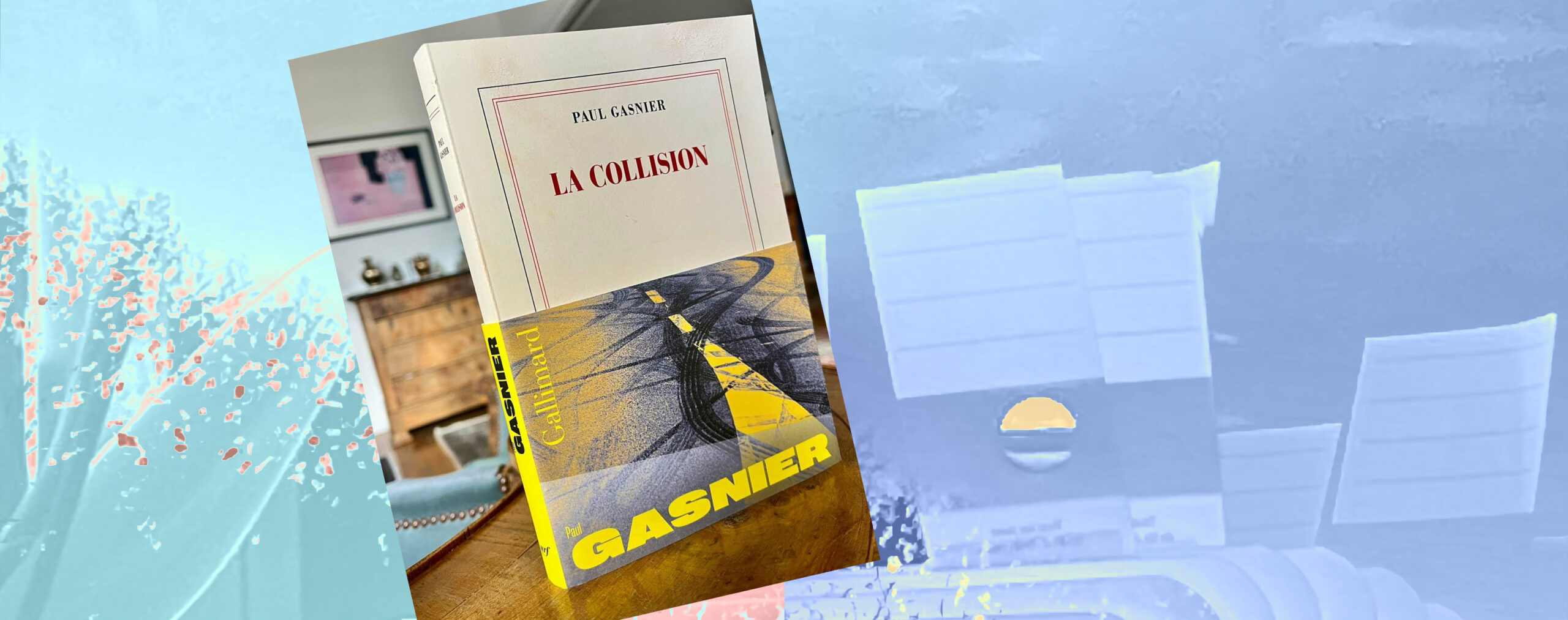*Satie*, Un roman pour un centenaire.
Un roman qui a pour titre *Satie*, on aurait presqu’envie de dire : comme tous les romans pour paraphraser le compositeur qui disait : « je m’appelle Erik Satie comme tout le monde ».
Patrick Roegiers, l’auteur du roman, lui écrit Satie comme personne. Ce qui n’est pas rien. Une biographie ? Me direz-vous. Satie en bon normand aurait pu répondre : peut-être bien que oui, peut-être bien que non.
Mais non, bel et bien un roman. Mais oui une biographie, d’autant plus vraie qu’elle devient fictive. Imaginez Satie, Alphonse Allais, Claude Debussy, John Cage, Cocteau, Suzanne Valadon, pour ne citer que ceux-là, réunis dans une même pièce, dans un même temps.
Une vrai *Parade* et on imagine l’oeil rieur du petit barbichu accroché à son parapluie.
Si Patrick Roegiers se permet ces grands écarts, totalement réussis d’ailleurs, ( on ne sent pas de résistance dans les tendons, comme on n’entend pas les os craquer ), c’est que Satie a, lui, réussi à faire le grand pont avec les générations qui ont suivi.
La révélation de la lenteur et du blanc musical, la révolution qu’a opérée le musicien d’Arcueil, aussi importante que celle d’un Stravinsky, ne furent pas des écueils.
Aucune sécheresse dans ce roman, Patrick Rogiers comme un familier d’Eric Satie nous invite en sa compagnie. C’est du vivifiant, c’est du sensible, c’est de l’admiration qui se transmet et se ressent, une musique des mots qui aime la musique. Une histoire qui se compose, avec des époques qui se juxtaposent aussi nettes et précises que les juxtapositions mélodiques qu’affectionnait Eric Satie.
Si Satie est l’auteur de *morceaux en forme de poire*, Patrick Rogiers a réussi un roman qui se déguste lentement comme un dessert en pomme de foire.
Paru en 2025 aux Éditions Grasset, *Satie* de Patrick Roegiers rend ainsi un hommage étonnant au compositeur décédé voilà cent ans, le premier juillet 1925.